L'Actu vue par Remaides : « EACS 2025 : l’alerte des chercheurs-ses et militants-es face au désengagement dans la lutte contre le VIH »
- Actualité
- 22.10.2025

Bruno Spire, chercheur, personne vivant avec le VIH, directeur de recherche à l’Inserm et président d’honneur de AIDES, prononce un discours à la plénière d’ouverture de la conférence EACS 2025 à Paris le 15 octobre 2025. Crédit : Fred Lebreton
Par Fred Lebreton
EACS 2025 : l'alerte des chercheurs-ses et militants-es face au désengagement dans la lutte contre le VIH
Lors de la conférence EACS 2025 à Paris (15 au 18 octobre), chercheurs-ses et acteurs-rices communautaires ont tiré la sonnette d’alarme face à la baisse des financements et au désengagement généralisé autour du VIH dans le monde. Les signataires de la Déclaration communautaire de Paris 2025 appellent l’Europe à reprendre le flambeau de la lutte pour tenir la promesse d’un monde sans sida d’ici 2030.
Quelques mots sur l’EACS, (European AIDS Clinical Society) qui est une société scientifique européenne fondée en 1991. Elle regroupe des cliniciens-nes, chercheurs-ses et experts-es du VIH issus-es de toute l’Europe. Elle joue un rôle majeur dans la recherche, la formation et la définition des recommandations cliniques sur la prise en charge du VIH et des co-infections (comme l’hépatite B ou C). Tous les deux ans, l’EACS organise une grande conférence internationale où se rencontrent scientifiques, professionnels-es de santé et acteurs-rices communautaires pour présenter les dernières avancées médicales, échanger sur les politiques de santé et renforcer la coopération européenne dans la lutte contre le virus. Cette année, la conférence avait lieu à Paris du 15 au 18 octobre.

Façade du Palais des Congrès de Paris qui accueillait la conférence EACS 2025 du 15 au 18 octobre. Crédit : Fred Lebreton
« Plus personne ne se soucie du VIH ! »
Mercredi 15 octobre 2025, il est quatorze heures passées au Palais des Congrès, porte Maillot. Mon badge presse autour du cou, quelques exemplaires de Remaides déposés au stand interassociatif, un café avalé à la hâte avec un confrère anglais, et me voilà déjà en route vers le point presse de l’EACS. La salle, prévue pour une centaine de personnes, sonne vide. Nous sommes moins de dix journalistes à nous éparpiller dans cet espace trop grand. Sur l’estrade, les quatre co-chairs prennent place. L’ambiance a quelque chose d’intime comme si nous assistions à une répétition générale avant l’arrivée du « vrai » public. Les co-chairs se prêtent au jeu des questions-réponses, conscients-es sans doute que, pour aujourd’hui, la presse n’est pas au rendez-vous.
Professeure de maladies infectieuses à Sorbonne Université et cheffe du service des maladies infectieuses de l’hôpital Saint-Antoine (Paris, AP-HP), Karine Lacombe ne cache pas sa fierté de voir cette conférence se dérouler à Paris : « Nous nous sommes beaucoup battus pour que cette conférence ait lieu ici, dans l’épicentre français de l’épidémie. » Pour elle, la tenue de l’événement dans la capitale n’a rien d’anodin : c’est une manière de rappeler que : « La France et d’autres pays européens ne sont pas sur la bonne voie pour éliminer le VIH d’ici 2030. » L’infectiologue dénonce un « tournant inquiétant » marqué par une baisse des financements et une indifférence croissante : « Plus personne ne se soucie du VIH ! » regrette-t-elle, fustigeant le désengagement des décideurs-ses et des médias généralistes qui brillent par leur absence à cette conférence. Elle rappelle pourtant que « le VIH continue de tuer et de se transmettre », alors même que les outils de prévention et de traitement « n’ont jamais été aussi efficaces ». Karine Lacombe alerte sur le risque d’un retour de flamme de l’épidémie si l’effort collectif se relâchait : « Si les financements diminuent, nous risquons de voir resurgir une épidémie florissante. » À Paris, souligne-t-elle, la mobilisation communautaire reste cruciale : « C’est un honneur, cette année, d’être à l’avant-garde de la lutte contre l’épidémie. »

La Pre Karine Lacombe, professeure de maladies infectieuses à la Faculté de santé de Sorbonne Université et cheffe de service des maladies infectieuses et tropicales de l’hôpital Saint-Antoine à Paris (AP-HP) prend la parole à la conférence de presse de lancement de l’EACS 2025. Crédit : Fred Lebreton
« Le gouvernement français réduit lui aussi de plus de moitié ses financements »
De son côté, Bruno Spire, directeur de recherche à l’Inserm (Institut national de la santé et de la recherche médicale) et président d’honneur de AIDES, salue « l’honneur » d’une participation communautaire pleinement reconnue dans la gouvernance de l’événement. Il souligne que l’inclusion des personnes vivant avec le VIH, des chercheurs-ses et cliniciens-nes reste « spécifique à notre champ », fruit d’une « capacité à construire ensemble des réponses » que d’autres domaines médicaux n’ont pas su adopter.
« Peut-être est-ce aussi pour cela qu’ils coupent les financements : parce que notre approche collective est plus transformatrice que lorsqu’on agit chacun dans son coin », glisse-t-il, mi-ironique, mi-inquiet. Une inquiétude justifiée : les coupes budgétaires frappent durement le réseau international Coalition PLUS, qui regroupe plus de 120 organisations communautaires. « Le choc est réel », prévient-il. Diagnostics tardifs, ruptures de traitement, projets de recherche stoppés, notamment autour du lénacapavir : les conséquences se font déjà sentir. Et si Bruno Spire déplore l’arrêt du Pepfar américain, il rappelle que « le gouvernement français réduit lui aussi de plus de moitié ses financements », fragilisant des associations contraintes de licencier des salariés-es ou de fermer. Au-delà des moyens, il appelle enfin à une refondation politique : « L’Europe doit s’impliquer davantage dans les questions de santé publique. Ce n’est pas normal qu’elle fixe le pourcentage de cacao dans une tablette de chocolat, mais pas les politiques de santé qui touchent directement la vie des gens. ».

Bruno Spire, chercheur vivant avec le VIH, directeur de recherche à l’INSERM et président d’honneur de AIDES prend la parole à la conférence de presse de lancement de l’EACS 2025. Crédit : Fred Lebreton
« Face aux coupes budgétaires, l’Europe risque de reculer dans la lutte contre le VIH »
« Cette année nous a réservé une mauvaise surprise », déplore le Pr Miłosz Parczewski, président de l’EACS et chef du service des maladies infectieuses à l’Université médicale de Poméranie, à Szczecin (Pologne). En cause : les coupes budgétaires liées au Pepfar, le principal programme américain de lutte contre le VIH, qui fragilisent les réponses dans de nombreux pays et sur plusieurs continents, « y compris en Afrique, mais aussi en Europe, dans des pays particulièrement touchés par l’épidémie, comme l’Ukraine ». Ces restrictions affectent aussi les capacités d’action de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), déjà confrontée à des réductions de moyens. « Ces diminutions de financement nous font reculer d’un pas », regrette-t-il, alors que certaines régions connaissent désormais « une pénurie de Prep », y compris hors d’Afrique, « dans un contexte d’expansion des épidémies ». Le professeur s’inquiète des répercussions à venir sur le nombre de nouvelles infections. Il alerte aussi sur l’évolution du visage de l’épidémie en Europe : selon le CDC, 36 % des nouveaux diagnostics en 2023 concernent des migrants-es. « L’épidémie est aujourd’hui associée à des populations marginalisées, difficiles à atteindre », rappelle-t-il. D’où la nécessité, insiste-t-il, « de redoubler d’efforts pour rejoindre ces communautés » et d’éviter que les progrès accomplis ne soient réduits à néant par la fragilité des financements internationaux.
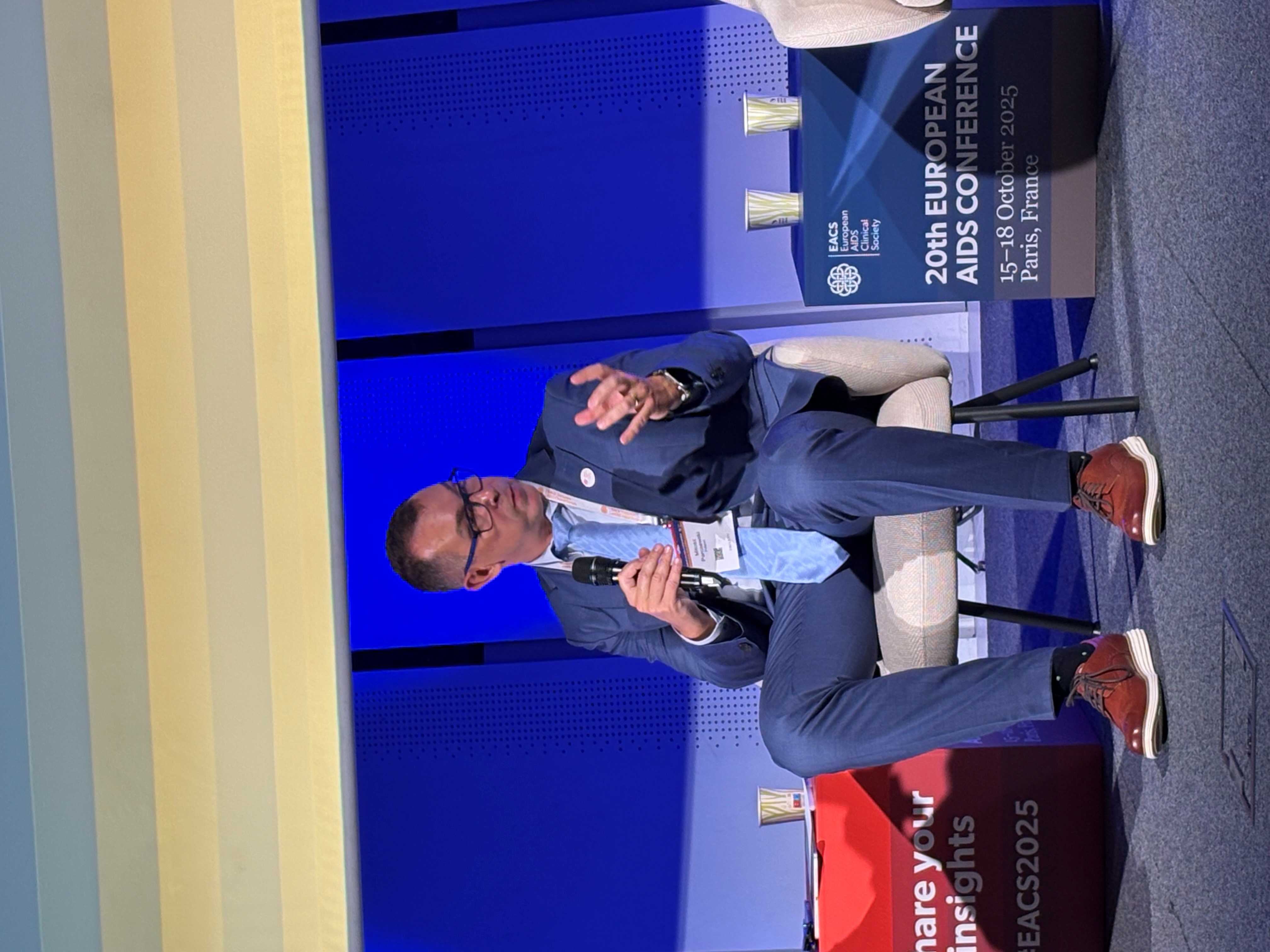
Le Pr Miłosz Parczewski, président de l’EACS, consultant national pour les maladies infectieuses en Pologne et chef du service des maladies infectieuses à l’Université médicale de Poméranie, à Szczecin (Pologne) prend la parole à la conférence de presse de lancement de l’EACS 2025. Crédit : Fred Lebreton
« L’Europe doit reprendre le flambeau de la lutte contre le VIH »
Professeur de maladies infectieuses à l’Université de Paris et chef de service des maladies infectieuses des hôpitaux Saint-Louis et Lariboisière (Paris), le Pr Jean-Michel Molina rappelle que « la lutte contre le VIH est loin d’être terminée » et appelle l’Europe à « reprendre le leadership » dans la prévention, le traitement et la recherche. Il souligne que « les récentes données sur les nouvelles infections en France ne sont pas bonnes », et que « beaucoup reste à faire » pour enrayer la dynamique. Le chercheur, pionnier des études sur la Prep, met en avant les avancées françaises sur les traitements injectables à longue durée d’action. « Nous menons à Paris la première étude européenne avec le cabotégravir, et, avec nos collègues britanniques, la première étude de Prep avec le lénacapavir », précise-t-il, annonçant la présentation des premiers résultats de l’étude Purpose 5. Pour lui, il est urgent « d’améliorer l’accès à la Prep à l’échelle européenne », notamment en Europe de l’Est, où les nouvelles infections progressent le plus rapidement. « Puisque la France et le Royaume-Uni ont été pionniers, à nous de montrer la voie », insiste-t-il. Dans une Europe marquée par les coupes budgétaires américaines, le Pr Molina voit une « formidable occasion de réaffirmer notre rôle moteur » et de mobiliser les décideurs politiques pour que la Prep devienne enfin accessible « à toutes et à tous ». Zèle d’optimisme ou méthode Coué ? L’avenir nous le dira…
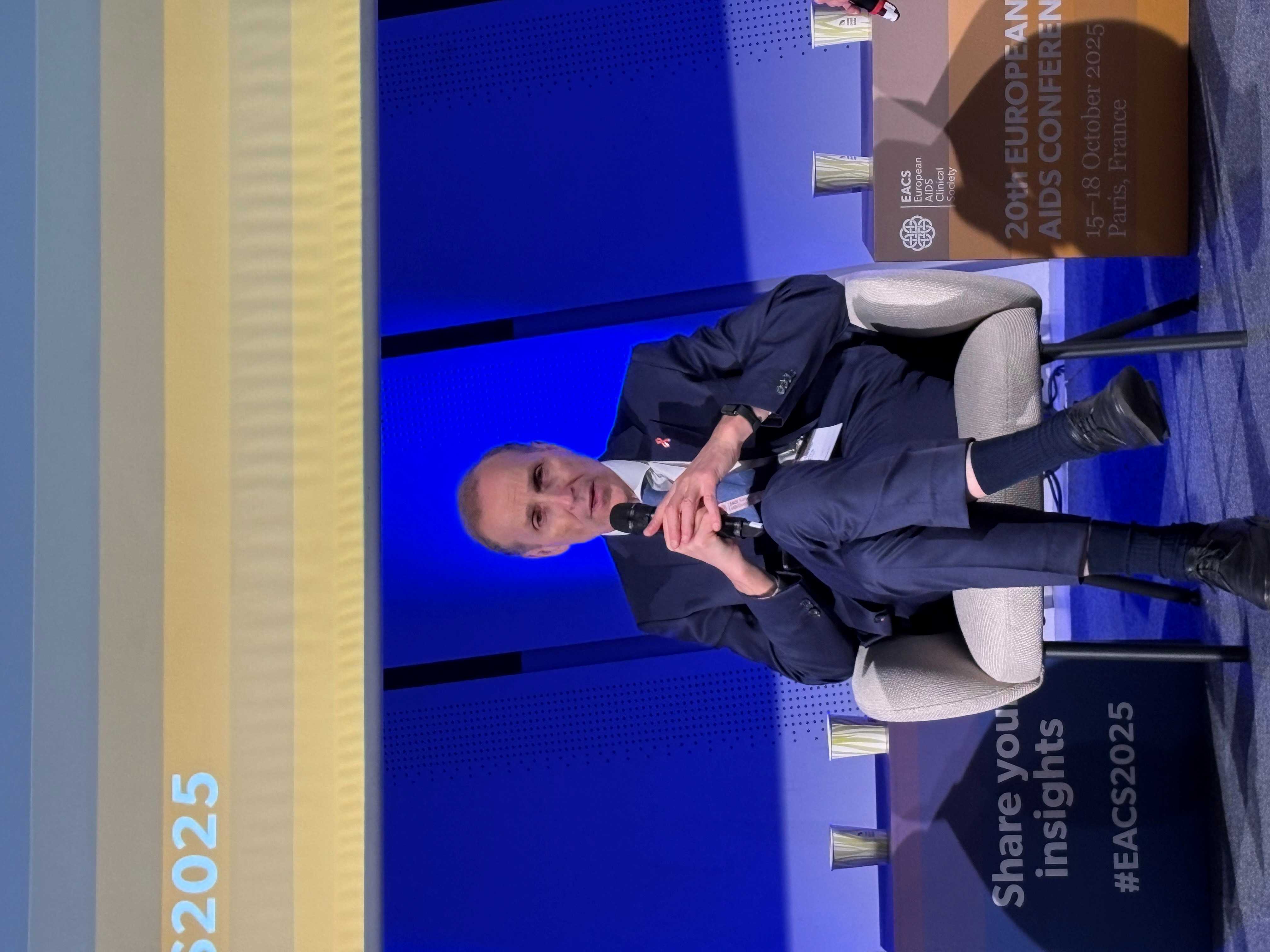
Le Pr Jean-Michel Molina, professeur de maladies infectieuses à l’Université de Paris et chef de service des maladies infectieuses des hôpitaux Saint-Louis et Lariboisière (AP-HP), prend la parole à la conférence de presse d’ouverture de l’EACS 2025. Crédit : Fred Lebreton
« Nos communautés ont besoin de croiser nos regards militants et scientifiques »
Je m’installe au second rang dans le grand auditorium du Palais des Congrès, une salle habituellement réservée aux concerts (Charles Aznavour y a chanté, paraît-il, ses plus grands tubes). Aujourd’hui pourtant, les projecteurs ne s’allument pas pour la chanson, mais pour la science et l’engagement communautaire. Après les habituels mots d’introduction et les remerciements institutionnels, le professeur Miłosz Parczewski invite Bruno Spire à prendre la parole. Le militant salue la place accordée aux communautés dans cet événement scientifique majeur. « Je me réjouis que l’EACS fasse désormais une place aux communautés et que cela fasse partie des habitudes », déclare-t-il, rappelant que le mot d’ordre « Rien pour nous sans nous », vieux de plus de quarante ans, reste au cœur du combat. Le président d’honneur de AIDES souligne la vitalité des acteurs-rices communautaires français-es, particulièrement en Île-de-France, qui travaillent « avec et pour les populations clés » : hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes, personnes trans, usagers-ères de drogues, migrants-es d’Afrique subsaharienne et travailleurs-ses du sexe. Pour lui, « la mobilisation des communautés est cruciale », notamment dans un contexte où « tous les conservatismes nous menacent ».
Le militant dresse un constat alarmant : « Les subventions publiques, qu’elles concernent les associations ou la recherche, baissent », entraînant « moins de travailleurs communautaires, moins d’actions vers les publics les plus vulnérables ». Il dénonce une situation paradoxale dans « le pays des droits de l’homme », où « la liberté associative est menacée ». Sans le travail des associations, prévient-il, « les personnes les plus exposées ont peu de chance de se faire dépister ou d’être maintenues dans le système de soins ». Abandonner ces publics reviendrait à « renoncer à l’objectif de l’arrêt de l’épidémie fixé collectivement au niveau international ». Le chercheur s’insurge aussi contre « la surenchère politique » visant à restreindre l’accès aux soins des étrangers malades, contre la banalisation de « la transphobie et la xénophobie », et contre les attaques locales visant la réduction des risques à Paris, menées par « des commerçants soutenus par des élus toxicophobes et ignorant les résultats de la science ». Enfin, le chercheur rappelle que « l’aide au développement, qui permet la sauvegarde de millions de vies », subit des coupes brutales, y compris en France, « pays si prompt à donner des leçons aux autres ». Malgré ce contexte sombre, Bruno Spire conclut sur une note d’espoir et d’unité : « Nos communautés ont besoin de croiser nos regards militants et scientifiques. C’est en étant unis que nous pourrons faire reculer l’obscurantisme et faire avancer la santé publique. »
« Cinq ans pour tenir la promesse d’un monde sans sida »
Seule femme politique présente à cette plénière d’ouverture, Anne Hidalgo prononce un discours à la fois personnel et porteur d’espoir. La maire de Paris débute en rendant hommage à « toutes celles et ceux qui poursuivent le combat avec courage et dignité », avant d’évoquer sa propre histoire : « Je fais partie de cette génération qui a découvert la sexualité et le sida en même temps, et qui a vu partir beaucoup de ses amis. » Elle rappelle que Paris, « ville-refuge », fut aussi « la ville européenne la plus touchée » au plus fort de l’épidémie de sida, avant de devenir un « berceau de la recherche et de la solidarité ». Anne Hidalgo ancre son propos dans un moment décisif : « L’horizon d’une génération sans sida n’est plus un rêve, mais une promesse que nous devons tenir. » Cette promesse, répète-t-elle comme un mantra, doit se concrétiser dans les cinq années qui viennent : « Cinq ans, c’est le temps qu’il nous reste pour atteindre les objectifs fixés par l’Onusida pour 2030, cinq ans pour faire de cette histoire un combat gagné, cinq ans pour ne pas laisser retomber l’attention. » La maire de Paris met en garde contre « la lassitude » et le risque de croire que « tout serait déjà accompli ». Le sida, rappelle-t-elle, « frappe encore, notamment les plus vulnérables, là où persistent les inégalités et la stigmatisation ». Pour tenir la promesse de 2030, deux conditions sont indissociables : « les moyens et les droits ». Continuer à financer la recherche, soutenir la prévention et garantir un accès universel au traitement, tout en combattant les discriminations : « On ne vainc pas une épidémie en excluant. » Celle qui vit ses derniers mois en tant que Maire de Paris défend aussi l’héritage de la démocratie sanitaire née de la lutte contre le VIH, « cette alliance unique entre chercheurs, soignants, personnes concernées et responsables publics ». En évoquant la stratégie Paris sans sida, pensée « avec les populations les plus exposées, pour elles, mais jamais sans elles », elle salue les progrès déjà accomplis et appelle à poursuivre avec détermination. Face aux « fake news » et à la défiance envers la science, l’édile exhorte à réaffirmer la rigueur et la confiance : « Une épidémie se combat avec la société civile, pas sans elle. » Optimiste et déterminée, Anne Hidalgo conclut dans un ton rassemblant : « La fin du sida est à la portée de notre génération. Nous pouvons y arriver, nous devons y arriver. Ensemble, nous vaincrons. »

Anne Hidalgo, Maire de Paris, prononce un discours à la plénière d’ouverture de la conférence EACS 2025 à Paris le 15 octobre 2025. Crédit : Fred Lebreton
« Si la science suffisait… »
Eve Plenel, directrice de la santé publique de la Ville de Paris, prononce à son tour un discours incarné. « Une fois militante du VIH, toujours militante du VIH », affirme l’ancienne directrice de Paris sans sida. Devant la communauté scientifique, Eve Plenel retrace le chemin parcouru par la capitale depuis le lancement de l’initiative Fast Track Cities (les villes sans sida) en 2014, qui a permis de réduire d’un tiers les nouveaux diagnostics de VIH et de 45 % les hospitalisations liées à un diagnostic tardif. Ces progrès, souligne-t-elle, sont le fruit d’un dialogue constant entre recherche et action publique. Mais, prévient-elle : « La science ne suffit pas à déclencher l’action. » « Si la science suffisait », martèle Eve Plenel à plusieurs reprises, « nous n’aurions pas à nous battre tous les six mois pour défendre le droit des personnes migrantes à accéder à des soins de base », ni à démontrer encore l’efficacité de la réduction des risques ou des salles de consommation à moindres risques. Pour changer la donne, il faut « des organisations communautaires combatives » et « un leadership politique fort ». À Paris, rappelle-t-elle, la Ville a choisi de nommer clairement les inégalités systémiques : racisme, transphobie, homophobie, sexisme et de cesser de parler de « populations fragiles » pour désigner celles directement touchées par le VIH. « Nous avons appelé les choses par leur nom : au XXIe siècle, à Paris, l’incidence du VIH touche presque exclusivement les hommes gays et bisexuels, les diasporas d’Afrique subsaharienne, les femmes trans et les travailleuses et travailleurs du sexe », explique-t-elle. La municipalité a aussi « montré leurs visages et leur force » dans l’espace public et reconnu « l’excellence du travail communautaire », sans paternalisme. Eve Plenel profite de cette tribune publique pour rendre hommage à Demetre Daskalakis, infectiologue et activiste américain : « Il y a deux mois, le bureau de Demetre au siège du CDC à Atlanta a été criblé de balles par des terroristes antivaccins, encouragés par les discours du secrétaire américain à la Santé lui-même. Douze jours plus tard, Demetre a démissionné de son poste de directeur du Centre national pour la vaccination et les maladies respiratoires, estimant que les conditions n’étaient plus réunies pour remplir son serment de protéger la santé du peuple américain. Voilà à quelle vitesse la situation peut basculer pour les défenseurs de la santé publique ». Glaçant.

Les co-chairs de la conférence EACS 2025 et représentants-es de la Déclaration communautaire de Paris 2025 posent avec Anne Hidalgo, Maire de Paris, et ses adjoints-es à la Santé et aux Discriminations lors de la plénière d’ouverture de la conférence EACS 2025 à Paris le 15 octobre 2025. Crédit : Fred Lebreton
Les communautés réclament une Europe solidaire pour en finir avec le VIH
Last but not least, la dernière personne à prendre la parole à cette plénière d’ouverture est Caroline Andoum, la fondatrice et directrice générale de l’association Bamesso et ses Amis. Créée en 2008, l’association a pour objectif de promouvoir la santé sexuelle auprès des populations africaines et caribéennes en situation de précarité, de vulnérabilité, d'isolement et éloignées du système de santé. Avec conviction et émotion, la militante fait une lecture de la Déclaration communautaire de Paris 2025, un texte fort signé par le Comité communautaire et inter associatif de l’EACS 2025. Elle y rappelle que l’Europe dispose aujourd’hui de tous les outils pour mettre fin à l’épidémie du VIH, qui touche encore 2,3 millions de personnes sur le continent. Pourtant, « alors que nous devrions parcourir le dernier kilomètre vers l’élimination du VIH, les structures communautaires s’affaiblissent et les budgets se restreignent », rappelle-t-elle. Ces associations, piliers de la réponse, sont pourtant celles qui « réduisent les délais de diagnostic, accompagnent les personnes vivant avec le VIH et permettent aux plus exposées d’accéder à la prévention ». En Europe, le constat demeure alarmant : plus de 100 000 nouveaux diagnostics ont été posés en 2023, dont 52,4 % à un stade tardif. Les personnes étrangères sont les premières concernées : « Elles cumulent les obstacles, absence de droits, méconnaissance des systèmes de santé, manque d’interprètes et d’accès au séjour », rappelle la déclaration. En France, près de la moitié des personnes migrantes nouvellement diagnostiquées ont été infectées après leur arrivée, dans des conditions de grande précarité et d’exposition aux violences. Les politiques migratoires répressives et la remise en cause récurrente de l’Aide médicale d’État « éloignent les plus vulnérables de la prévention et du soin ».
Les signataires alertent aussi sur les conséquences internationales du désengagement financier : « L’arrêt ou la réduction des financements des États-Unis et des pays européens aura un impact majeur dans les pays à ressources limitées. » Dans un contexte où « les droits humains sont fragilisés et où l’intolérance gagne du terrain », les associations communautaires demeurent « un maillon essentiel du déploiement de la santé publique ». La déclaration conclut sur un appel clair aux États et à l’Union européenne : renforcer sans délai leur soutien aux acteurs-rices communautaires, garantir des politiques de santé fondées sur les droits humains et « assurer à toutes et tous, y compris aux personnes étrangères, un accès égal à la prévention, au soin et à la dignité ».
Pour signer la déclaration communautaire de Paris 2025
