L’Actu vue par Remaides : « Patrick Papazian : "La sexualité normale, ça n’existe pas, c’est un fantasme collectif" »
- Actualité
- 13.10.2025

Patrick Papazian, médecin sexologue et auteur su "Cocker du sexologue". Photo : Xavier Héraud
Propos recueillis par Fred Lebreton
Patrick Papazian : "La sexualité normale ; ça n'existe pas, c'est un fantasme collectif"
Dans son livre « Le cocker du sexologue » (Éditions de l’Opportun) Patrick Papazian prête sa voix à Mrs Robinson, son fidèle compagnon à quatre pattes, pour explorer sans tabou les paradoxes de l’intimité contemporaine. Fétichismes, violences, VIH, vieillissement, normes sexuelles : rien n’échappe à ce miroir affectueux, tantôt grave, tantôt tendre et souvent drôle, qui invite à abandonner la quête de l’orgasme parfait pour retrouver, tout simplement, le lien avec les autres et avec soi-même. Entretien avec l’auteur, médecin sexologue et militant.
Remaides : Qui se cache derrière « Mrs Robinson », ce cocker devenu témoin discret de vos consultations ? Pourquoi avoir fait de lui le narrateur de votre récit ?
Patrick Papazian : Mrs Robinson, c’est mon chien adoré, bien sûr, mais au-delà, c’est le regard que nous devrions tous porter sur la sexualité : un regard tendre, jamais moralisateur, curieux sans être intrusif. Curieux de l’autre, dans le bon sens du terme, de ce qui n’est pas soi. Et en même temps, Mrs Robinson est une figure qui s’interroge, comme on le voit au fil des pages. Une interrogation centrale traverse tout le récit : quelle est la nature du lien avec autrui ? Le titre initial du roman, c’était « La laisse ». Une métaphore que j’essaie de filer tout au long du livre pour parler du lien entre les personnes. Une laisse ni trop courte ni trop longue… parfois même inexistante. C’est une manière de réfléchir aux attaches et aux attachements. Mrs Robinson, c’est cette partie de nous que les difficultés de la vie affective et sexuelle ont tendance à faire taire, à faire oublier et qu’il faut retrouver. C’est un peu le clown triste en nous, qui ne demande qu’à rejouer, qu’à rire à nouveau. C’est vraiment cette dimension ludique, malmenée par les épreuves affectives ou sexuelles, qu’il faut réveiller.
Remaides : Votre livre n’escamote ni les tabous ni les zones d’ombre de la sexualité, allant du fétichisme aux violences sexuelles. Qu’est-ce que le sexe dit de notre époque ? Et pourquoi est-ce encore si difficile d’en parler aujourd’hui ?
Le sexe, c’est nous. C’est notre époque, sans filtre. Il agit comme un miroir grossissant de nos accomplissements… et de nos impasses. Ce que la sexualité dit de notre époque, à mon sens, c’est qu’elle manque cruellement de nuances, mais déborde de paradoxes. On vit une époque où coexistent les pires violences sexuelles à l’échelle mondiale, et en même temps une mise en avant inédite du consentement. Les fétichismes s’exposent, se diversifient, circulent librement… mais les jugements, eux, sont de plus en plus hâtifs. On assiste à une normalisation des rapports, avec une sexualité omniprésente dans les images, notamment via la pornographie, mais paradoxalement de plus en plus absente dans les corps, dans les expériences réelles, en particulier chez les jeunes, comme l’a révélé l’enquête de l’Inserm [«Contexte des sexualités en France 2023 », lire notre article, ndlr]. C’est précisément ce paradoxe-là que j’ai voulu explorer dans le livre. Finalement, parler de sexe reste difficile parce que cela nous confronte à toutes les contradictions de notre époque, et le risque est grand de tomber rapidement dans la caricature. La sexualité, c’est un peu comme le miroir de Blanche-Neige : ça ne ment pas, mais ça dérange. Ça grossit le trait. Ce n’est pas un miroir déformant, c’est un miroir grossissant. Il zoome sur nos paradoxes, sur ce manque de nuances qui traverse toute notre époque.
Remaides : Dans le chapitre consacré à Christian, un homme vivant avec le VIH, vous évoquez le « pill blues ». De quoi s’agit-il ?
Dans ce chapitre, j’ai vraiment voulu aborder cette distorsion cognitive entre, d’un côté, ce que l’on se représente du VIH, ce que l’on en a vécu, ce qu’on a vu chez soi ou chez ses proches et, de l’autre, les bénéfices du traitement, à savoir une vie, sur le plan médical en tout cas, dont les choses sont presque normales. C’est un peu comme un retour au calme dans l’œil du cyclone. Il y a là tout le paradoxe de porter en soi ce virus, qui fut l’une des maladies les plus sulfureuses et incomprises du XXe siècle, tout en n’ayant, pour beaucoup, heureusement, aucun signe extérieur ni problème particulier. Pour moi, c’est ça le « pill blues » : ce sentiment profondément paradoxal. Et parfois aussi un sentiment de trahison communautaire. Se dire : les autres sont partis ; moi, je suis encore là, pourquoi ? Pourquoi ne suis-je pas parti ? Ce sont tous ces paradoxes dans lesquels les personnes vivant avec le VIH peuvent se retrouver. Et je pense sincèrement que cela ne peut être compris que par d’autres personnes concernées. C’est ce que j’ai tenté de raconter à travers le personnage de Christian, qui incarne à la fois cette histoire communautaire et l’histoire du VIH. Il ne se remet pas d’être vivant et en capacité de jouir de la vie.
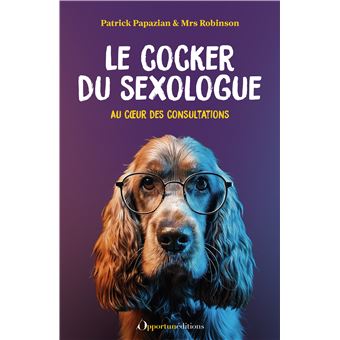
Remaides : Plus largement, quelles sont les problématiques les plus abordées chez vos patients-es vivant avec le VIH lors de vos consultations de sexologie ?
Pour moi, la difficulté numéro un, c’est la rencontre avec l’autre. C’est-à-dire l’annonce du statut sérologique, qui reste un sujet compliqué, et un facteur d’isolement social. On retrouve toujours les mêmes débats, vraiment. J’ai l’impression que ce sont toujours les mêmes questionnements, malgré U = U : Est-ce que je dois le dire ? Est-ce que je ne dois pas le dire ? Est-ce que je peux ne pas le dire ? Comment cela va-t-il être reçu ? etc. Pour beaucoup de personnes, cela se traduit par : j’hésite à rencontrer, je reste dans ma coquille. C’est, à mon sens, le sujet numéro un. Et le sujet numéro deux, qui est très lié à la courbe démographique du VIH, ce sont les inquiétudes sociales, affectives et sexuelles liées au vieillissement. Par exemple : si je vais en Ehpad, est-ce que je serai la personne âgée qu’on met à l’écart ? Comment vais-je vieillir avec le VIH ? Est-ce que je vais continuer à lutter, alors que je n’ai plus forcément l’énergie pour me battre, ni pour expliquer ? Ce sont vraiment des questionnements sociaux et médicaux importants autour du vieillissement avec le VIH. La sexualité aussi est source d’inquiétudes. D’une part, parce que des dysfonctions sexuelles apparaissent en avançant en âge, certaines étant liées à des pathologies cardiovasculaires, parfois neurologiques, plus souvent associées au VIH ou à des traitements anciens. Et puis, se pose la question de l’intimité dans un lieu de vie communautaire comme un Ehpad : comment vais-je vivre ma sexualité ? Ce que j’aime, ce que je désire ? Moi, j’ai déjà eu des patients qui me posaient ce genre de questions : est-ce qu’on a le droit de faire venir un plan Grindr dans sa chambre d’Ehpad ? Est-ce que c’est autorisé ? [Grindr est une application de rencontre utilisée principalement par les hommes ayant des rapports sexuels avec d'autres hommes, ndlr]. Bien sûr, on peut dire que c’est le côté un peu sombre, mais il y a aussi des discussions plus joyeuses, comme l’idée d’imaginer des lieux communautaires de vieillissement. Se demander : et si on achetait une maison à plusieurs, pour vieillir ensemble ? Ce sont aussi ces formes de réflexions que l’on retrouve, par exemple, chez des femmes migrantes vieillissantes vivant avec le VIH. Là aussi, il y a des inquiétudes, mais surtout des tentatives d’organisation. Parce qu’on sent bien que ce sont des sujets encore très peu pris en compte par la société.
Remaides : Un chapitre est consacré aux consultations de sexologie que vous donnez au sein de l’association Ikambere. Pourquoi était-ce important pour vous de parler de cette association dans ce livre ?
Pour la petite anecdote, lors des relectures, l’éditrice qui corrigeait l’ouvrage a indiqué dans les commentaires : « Ce chapitre est magnifique, c’est mon préféré ». Cela montre à quel point j’y ai mis une forte charge émotionnelle, parce que ce chapitre est très personnel. J’espère que cette émotion a réussi à transparaître. En tout cas, beaucoup de personnes y ont été sensibles et ont voulu en savoir davantage sur cette question. Pour moi, Ikambere est une association qui devrait faire la une de tous les journaux, tout le temps. Cette association réalise un travail extraordinaire depuis 1997. Elle accompagne des femmes vivant avec une maladie chronique, ainsi que des personnes en situation de précarité, avec pour objectif de permettre leur autonomie. Il s’agit souvent de femmes originaires d’Afrique, mais pas uniquement. Ce que j’ai voulu montrer dans ce chapitre, c’est que ces femmes mais aussi des hommes, ont énormément à nous transmettre. Il y a aussi un point qui me tient particulièrement à cœur : tout le monde se gargarise aujourd’hui du mot « résilience ». On en prend une énorme rasade à chaque colloque… Ce que j’aime chez Ikambere, c’est qu’elles et ils ne sont pas dans l’effet de mode. Le mot résilience, elles et ils ne l’utilisent presque jamais. Leur devise, c’est : « Savoir = Pouvoir ». Et il y a aussi cette expression qui revient souvent : « Toujours debout ». Pour moi, ce sont là des valeurs nobles, incarnées dans des gestes concrets pour avancer, préserver sa santé et sa dignité. C’est exactement ce que j’aime : le concret, les actions, les mains tendues… pas les grands discours. Enfin, ce que j’ai voulu aussi montrer, c’est que la sexologie que je défends est une sexologie sans frontières. Une sexologie qui va vers les autres. C’est pourquoi j’ai tenu à montrer que les sexologues doivent sortir de leurs cabinets ou des hôpitaux où ils et elles exercent et aller dans les associations, sur les lieux de vie des personnes. Pour moi, cet « aller vers » est absolument essentiel, y compris en sexologie.
Remaides : Qu’aimeriez-vous que vos lecteurs-rices retiennent en refermant votre livre ? Un regard plus tendre sur leur propre intimité… ou l’envie de pousser la porte d’un cabinet de sexologie ?
Ce que j’aimerais vraiment, spontanément, que les gens retiennent, c’est qu’on est tous cabossés, quelque part, dans notre vie affective et sexuelle. Tout le monde traverse des difficultés dans ces domaines. L’« épanouissement sexuel », ça n’existe pas. C’est un mot que je bannis. Je déteste ce mot. Être « épanoui dans sa vie sexuelle », je ne sais même pas ce que ça veut dire. Donc oui, nous sommes tous cabossés. Nous ne sommes pas des cas isolés, on fait comme on peut. Et c’est déjà pas mal. C’est vraiment ça, pour moi, le message fort. C’est ce que j’essaie de faire passer à mes patients en consultation. Ce sont souvent des gens qui arrivent en regardant le bout de leurs chaussures, persuadés d’être les seuls à souffrir ou à éprouver des difficultés. Il faut sortir de cette idée qu’il y aurait, d’un côté, les gens « normaux » et « épanouis » sexuellement, et de l’autre ceux qui « en bavent ». On est tous malmenés, cabossés, à des degrés divers. Le vrai message, c’est de dire : on est tous en galère, on en bave, et on fait comme on peut. L’important, c’est d’en être conscient, de ne pas en avoir honte, et surtout, de ne pas se résigner. Ce n’est pas parce qu’il y a de la souffrance ou des blocages qu’il faut baisser les bras. Consulter un sexologue, c’est justement ne pas s’avouer vaincu. C’est s’offrir une chance d’aller mieux. Autant, il est normal d’être cabossé dans sa vie affective ou sexuelle, autant il ne faut jamais se dire que ça ne changera pas. Il y a des moments où on n’a plus d’estime de soi, plus d’énergie, où rien ne fonctionne… mais ce n’est jamais une fatalité. Ça vaut toujours le coup d’essayer des choses, de chercher des solutions. Et donc, d’aller chez un sexologue, par exemple. Mais attention, l’idée n’est pas de se poser dix mille questions sur sa supposée normalité. La « sexualité normale », ça n’existe pas, c’est un fantasme collectif. Beaucoup de gens courent après, mais personne ne l’a jamais vue. On ne sait même pas ce que ça veut dire. Et ce n’est certainement pas la norme qui mène à l’épanouissement. Ce sont le respect, la liberté, l’audace, l’exploration, le jeu. Mais sûrement pas la norme.
Remaides : Il y a, derrière cette idée de « norme », une injonction à l’orgasme et à la performance sexuelle…
Oui, et cela entraîne énormément de souffrance. D’une part, parce que les gens se mettent en quête de l’orgasme simultané, de la performance, de toute cette mise en scène… Et d’autre part, parce qu’ils ont honte de certaines envies ou fantasmes. Alors ils vont soit les taire, soit les vivre, mais dans la gêne ou la culpabilité. Là où, en réalité, on est tous pareils. C’est important, à un moment, de pouvoir se le dire, d’en sourire, et de poser un regard bienveillant sur soi-même.
Propos recueillis par Fred Lebreton
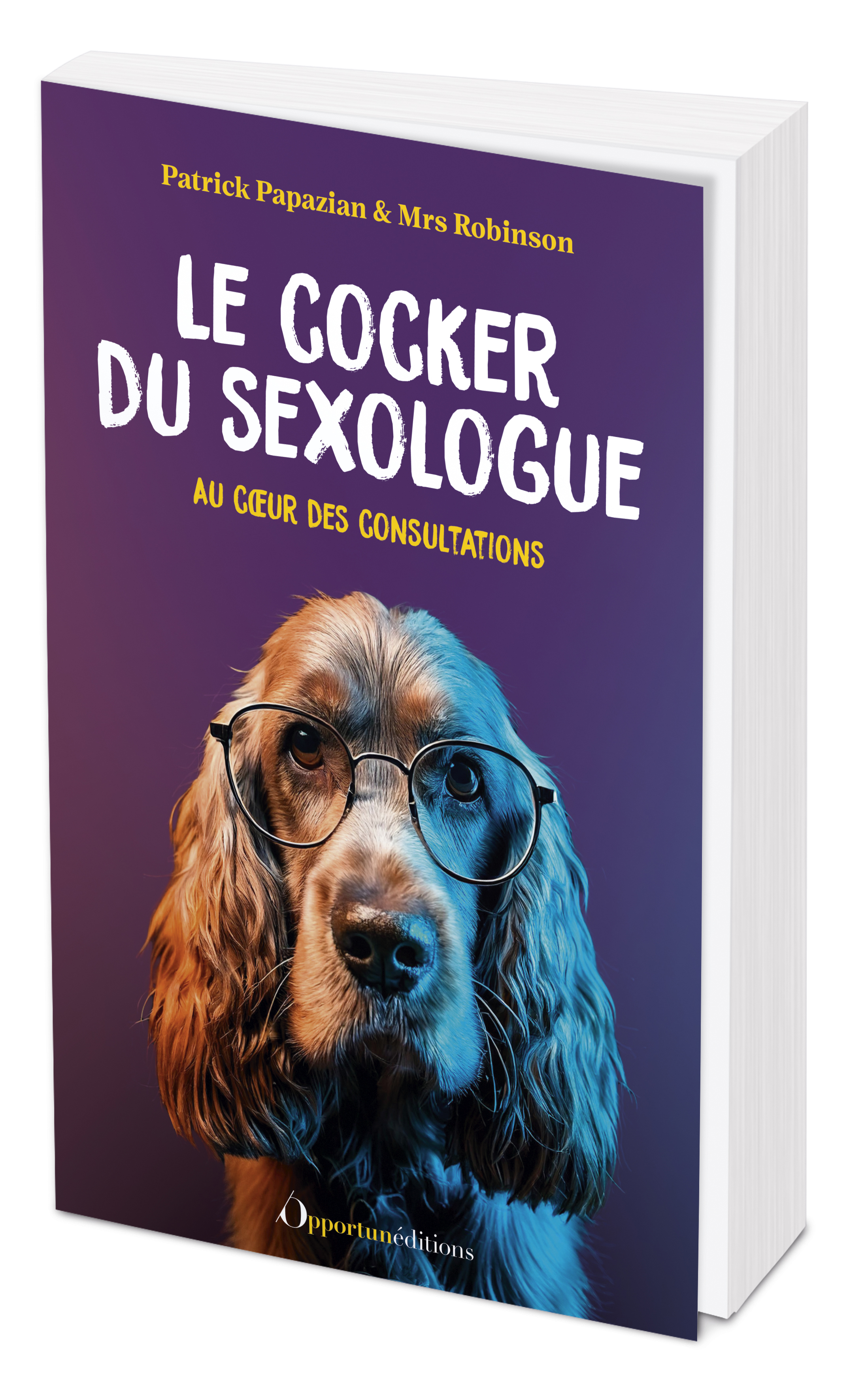
Le cocker du sexologue : dans l'intimité d'un cabinet de sexologie
Le docteur Patrick Papazian, médecin sexologue à Paris, nous ouvre les portes de son cabinet dans un récit singulier, à mi-chemin entre chronique médicale et introspection douce-amère. À ses côtés, Mrs Robinson, son cocker aussi discret qu’attachant, observe silencieusement les va-et-vient des patients-es, attentive aux moindres détails, à commencer par les chaussettes. À travers des consultations pleines de rires, de larmes et de confidences parfois surprenantes, Patrick Papazian dévoile un kaléidoscope d’histoires humaines où se croisent les désirs, les doutes, les tabous et les élans du cœur. Il y interroge, avec beaucoup d’empathie, de finesse et d’humanité, la complexité de l’intimité et des relations amoureuses. Le livre offre aux lecteurs-rices une plongée sensible dans ce huis-clos thérapeutique où chaque rencontre devient un moment suspendu. Médecin engagé, présent aussi bien à l’hôpital que dans les associations et centres de santé sexuelle, Patrick Papazian tient aussi la rubrique sexo de Remaides depuis 2020.
Le cocker du sexologue, par Patrick Papazian & Mrs Robinson ; parution le 22 mai 2025, aux Éditions de l’Opportun. 14,90 €
