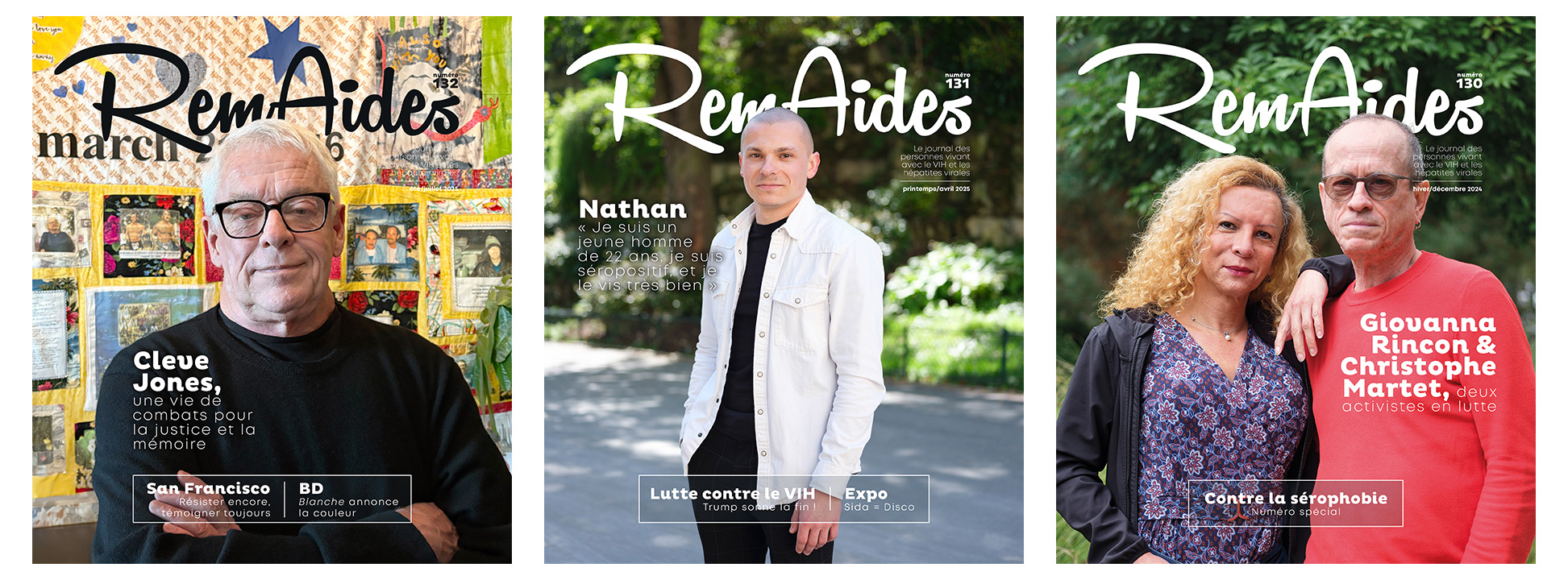Le 133ème numéro de Remaides est disponible en ligne !
- Remaides
- 14.11.2025
SIDA : QUAND L’ÉTAT DÉBRANCHE LES ASSOS
Par Jean-François Laforgerie,
Coordinateur de Remaides
 Le secteur de la lutte contre le VIH/sida en France tiendrat- il jusqu’en 2030 ? La question pourrait passer pour rhétorique si on en juge par la teneur très alarmiste d’une tribune publiée le 17 septembre, dans les colonnes de L’Humanité. « À l’initiative de Sidaction, 93 structures et 175 personnalités et acteurs/actrices de la lutte contre le VIH et de la solidarité ont signé une tribune rappelant que sans les associations, nous ne mettrons pas fin à l’épidémie de VIH », rappelait fort opportunément Florence Thune, directrice générale de Sidaction, dans un tweet, cet automne. Le constat fait dans la tribune est cinglant : « Les associations, actrices centrales et piliers historiques de la lutte contre le VIH, sont asphyxiées. Les fragiliser davantage, c’est fragiliser toute notre réponse à l’épidémie et voir se dégrader la qualité et condition de vie des usagers-ères. » Nous en sommes là. Rembobinons.
Le secteur de la lutte contre le VIH/sida en France tiendrat- il jusqu’en 2030 ? La question pourrait passer pour rhétorique si on en juge par la teneur très alarmiste d’une tribune publiée le 17 septembre, dans les colonnes de L’Humanité. « À l’initiative de Sidaction, 93 structures et 175 personnalités et acteurs/actrices de la lutte contre le VIH et de la solidarité ont signé une tribune rappelant que sans les associations, nous ne mettrons pas fin à l’épidémie de VIH », rappelait fort opportunément Florence Thune, directrice générale de Sidaction, dans un tweet, cet automne. Le constat fait dans la tribune est cinglant : « Les associations, actrices centrales et piliers historiques de la lutte contre le VIH, sont asphyxiées. Les fragiliser davantage, c’est fragiliser toute notre réponse à l’épidémie et voir se dégrader la qualité et condition de vie des usagers-ères. » Nous en sommes là. Rembobinons.
Si depuis près de quarante ans, la France a pu faire face à l’épidémie de VIH, c’est, comme le soulignent les signataires de la tribune, grâce à une « alliance solide entre les pouvoirs publics, les institutions de santé, la recherche et les associations de terrain ». Longtemps, la dynamique à l’œuvre a fonctionné, non sans accrocs, mais elle a fonctionné. Depuis plusieurs années et à la suite d’une série de décisions des pouvoirs publics, cette dynamique est en péril. Différentes mesures budgétaires et réglementaires ont été adoptées, elles ont eu pour conséquence de « fragiliser dangereusement » les associations. Il y a eu les baisses drastiques de contrats aidés et de contrats adultes-relais qui ont joué sur les moyens humains. À cela s’est ajoutée l’extension de la prime Ségur (2024) dans le secteur sanitaire, social et médico-social privé à but non lucratif. La mesure qui était attendue, avait du bon sur le papier, puisque cette revalorisation des salaires visait à en corriger les inégalités en vigueur dans ce secteur et à pallier un déficit d’attractivité. Le problème est que l’État a contraint tout un secteur à s’engager dans des dépenses salariales auxquelles il ne peut faire face. Faute de compensation financière par l’État (qu’elles sonnent creux d’ailleurs les promesses gouvernementales sur le sujet), cette décision met les structures dans une situation financière intenable. La raison est assez simple. Depuis un arrêté d’août 2024, les salariés- es à temps plein de ce secteur bénéficient d’une prime mensuelle de 183 euros nets, ce qui représente un montant de 238 euros bruts par salarié- e pour l’employeur-se, hors charges patronales. On imagine sans peine l’impact sur les ressources financières des structures concernées. De son côté, l’État affirme que « certaines compensations » ont été versées en 2024, d’autres le seraient en 2025. Du moins quand on aura une loi de finances. On sait ce qu’il est advenu en 2025 et ce qui se profile pour 2026…
Depuis plusieurs mois, différentes ONG alertent sur la situation et cela dans différents secteurs dont la santé sexuelle et la lutte contre le sida, l’aide aux victimes, la santé, la solidarité. Les contraintes financières sont telles que cela ne passe plus. À la clef : des plans sociaux, le gel des recrutements, la fermeture à moyen ou long terme de structures, etc. Alors même que les besoins sont de plus en plus forts et les demandes en nette hausse. Et ce n’est pas tout. S’ajoutent des coupes budgétaires (à tous les niveaux), voire un arrêt des financements publics. Mais l’attaque — appelons les choses par leur nom — n’est pas uniquement pécuniaire, elle prend d’autres formes. Dans leur ouvrage, L’État contre les associations ; anatomie d’un tournant autoritaire (Éditions Textuel), Antonio Delfini et Julien Talpin analysent comment l’État s’efforce de « mettre au pas politique » la société civile (tous domaines confondus, la santé comprise), notamment en utilisant le « contrat d’engagement républicain ». Un « contrat » que les associations doivent signer et respecter, au risque de perdre leur agrément et les financements publics. L’ouvrage, aussi édifiant que glaçant, montre à quel point la défiance (la rupture ?) est désormais installée entre le monde associatif et les pouvoirs publics sur la question des libertés associatives et publiques. On ne devrait pas être surpris, tant, depuis 2017, on assiste au plus haut niveau de l’État à une forme de mépris à l’égard des corps intermédiaires (syndicats, associations, principalement). Mais, il y a de quoi être en colère. Après tout, ce qui est à l’oeuvre aujourd’hui en France traduit une forme de « décrochage démocratique », comme le pointe la Fédération internationale des droits humains. Elle déplore « une régression préoccupante des libertés publiques ». Bien sûr, la France reste une démocratie, mais une démocratie dans laquelle on cherche, y compris du fait des pouvoirs publics, à décrédibiliser des associations et les combats qu’elles portent. Ce qui est fait aujourd’hui ne risque-t-il pas d’être amplifié dans les mains d’un pouvoir d’extrême droite illibéral ?
En colère, quand on voit qu’un rapport de l’inspection générale des Finances et de l’Inspection générale de l’Éducation, du Sport et de la Recherche, de juillet 2025 (commandé par l’ancien Premier ministre Michel Barnier) préconisait de rendre moins intéressantes les réductions d’impôts suites à des dons faits à des associations. Différents scénarios étaient envisagés prévoyant de 430 millions à un milliard d’euros d’économies. Le rapport expliquait que le « régime fiscal français [apparaissait] particulièrement avantageux » comparativement à ceux d’autres pays. Quelle bonne idée que d’ajouter à un contexte de disette, une pointe de racket. Évidemment, sans mesurer, ni anticiper l’impact financier sur les structures concernées.
En colère encore quand on voit — pour ne parler que de la lutte contre le sida — que les décisions prises fragilisent un secteur et avec lui la « réponse collective à l’épidémie, à la qualité de vie et aux conditions de vie des personnes usagères de ces associations », comme le souligne Florence Thune. « Nous sommes à l’étape la plus difficile : le dernier kilomètre, expliquent les signataires de la tribune de L’Humanité. Si nous échouons à atteindre les personnes les plus éloignées du système de santé — celles que la précarité, la discrimination, les inégalités ou l’isolement rendent inaccessibles aux dispositifs classiques — c’est l’ensemble de notre politique de santé sexuelle qui échouera. Sans les associations, aucune stratégie de santé sexuelle ne peut prétendre être universelle, équitable ou efficace. » En fait, désormais le risque est grand que « l’ambition de la France de mettre fin à l’épidémie [de sida] d’ici 2030 » ne soit qu’un « slogan vide », un renoncement aux engagements que la France a pris, un échec cinglant. Le secteur de la lutte contre le sida en France tiendra-t-il jusqu’en 2030 ? Nous en sommes là.
Abonnez-vous à Remaides
*Champs obligatoires