L’Actu vue par Remaides : « HAS, DDD : de nouvelles recommandations pour les personnes trans »
- Actualité
- 15.08.2025

Lors de la Marche des Fiertés de Paris en 2025, une personne porte un badge à propos
du sexe assigné à la naissance. Crédit photo : Fred Lebreton
Par Jean-François Laforgerie
HAS, DDD : de nouvelles recommandations
et une "décision-cadre"
pour les personnes trans
Saisie par le ministère chargé de la Santé et de l’Accès aux soins, la Haute Autorité de santé (HAS) a publié le 18 juillet le premier volet de ses recommandations portant sur « l’accompagnement et la prise en charge médicale des personnes trans souhaitant s’engager dans une démarche de transition de genre ». Ce premier volet est consacré aux personnes âgées de 18 ans et plus. Ces recommandations visent à « homogénéiser les pratiques » et « garantir une prise en charge sécurisée et de qualité ». La HAS élaborera dans un second temps des recommandations de bonnes pratiques concernant les mineurs-es. Le travail déjà engagé n’ayant pas abouti à un consensus. Présentation des points clefs.
En fin d’article, d’autres infos sur les personnes trans
Quelques éléments et notions en préambule
« Une personne trans est une personne vivant ou s’identifiant dans un genre différent de celui qui a été constaté à la naissance », propose d’emblée la HAS dans ses recommandations. « Le questionnement sur le genre peut conduire à s’engager dans un parcours de transition, lequel peut comprendre différentes démarches : sociale, administrative, médicale ».
La onzième version de la classification internationale des maladies (CIM-11) qui a été adoptée en 2018, a abandonné la notion de « transsexualisme ». Elle a notamment dépsychiatrisé « l’incongruence de genre ». Cette dernière a été transférée du chapitre des affections psychiatriques, vers celui des « affections liées à la santé sexuelle ». La dernière version du Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux (DSM5) adopté en 2013 distingue, par ailleurs, la « dysphorie de genre qui s’accompagne d’une souffrance cliniquement significative ou d’une altération du fonctionnement social », de « l’incongruence de genre [qui] n’est pas en soi un trouble mental ». Ces termes sont peu utilisés, voire contestés, par les personnes concernées, elles-mêmes. Et la HAS de préciser que les « standards de soins de la World Professional Association for Trans-gender Health (WPATH) situent la réalité "trans" comme un choix d’identité de genre en prenant acte de la « dépsychopathologisation » reconnue par la CIM-11, mettent l’accent sur la participation active des [patients-es] aux décisions qui concernent leur santé, et soulignent l’importance de la formation des [professionnels-les] de santé pour conduire les évaluations nécessaires et délivrer des soins adaptés ».
En France, les soins de transition sont pris en charge par l’Assurance maladie au titre de l’ALD hors liste. Le nombre de personnes suivies en ALD pour « troubles de l’identité sexuelle » s’élève en 2023 à un peu plus de 22 000, chiffre qui tend à augmenter ces dernières années.
Des conditions d’accès à des soins disparates sur le territoire
« Aujourd’hui, les conditions d’accès à des soins de qualité restent très hétérogènes sur le territoire », soulignent les recommandations de la HAS. L’institution constate d’ailleurs que « beaucoup [sont] en errance médicale ». De ce fait, les « personnes trans sont exposées à un risque de renoncement aux soins, d’automédication, de dépression ou encore de troubles anxieux pouvant aller jusqu’au suicide. »
D’après une étude récente, une personne trans sur cinq souffrirait de dépression indique la HAS. Par ailleurs, les discriminations subies, soulignées par la dernière décision-cadre de la Défenseure des droits (voir encart en fin d’article), s’ajoutent à ces difficultés en « alimentant un surrisque de violences (notamment dans l’espace public) ou de précarisation (difficultés professionnelles, d’accès à un logement…). Face à ces problématiques qui témoignent d’un enjeu de santé important, les professionnels manquent de repères. »
C’est dans ce contexte que le ministère chargé de la Santé et de l’Accès aux Soins a saisi la HAS en 2021 afin d’élaborer des recommandations pour améliorer l’accompagnement et la prise en charge médicale des personnes trans. Des travaux assez longs ont réuni 128 experts-es, c’est le fruit de leur travail commun qui prend aujourd’hui la forme de recommandations qui concernent « les adultes souhaitant s’engager dans un parcours de transition. » Ces recommandations « définissent les contours de la prise en charge dans sa diversité : prescription d’hormones, prise en charge chirurgicale, accompagnement psychologique et autres soins. »
La HAS complète les recommandations de deux documents : une synthèse à l’attention spécifique des médecins généralistes et une fiche décrivant la mise en œuvre du parcours de soins. Ces deux documents sont consultables et téléchargeables sur le site de la HAS.
Voici ce que disent les recommandations de la HAS :
Accueillir les demandes de transition sans stigmatisation et proposer un accompagnement adapté
« En fonction de la situation personnelle de la personne trans qui s’engage dans une démarche de transition médicale et de l’état d’avancement de sa réflexion, ses besoins varient, note l’institution. C’est pourquoi la HAS recommande de personnaliser la prise en charge et d’adapter l’accompagnement psychosocial tout au long du parcours. L’enjeu est de favoriser l’autonomie de la personne afin de l’aider à identifier et formuler des choix éclairés, dans le respect du principe d’autodétermination. Il est essentiel d’accueillir la personne sans jugement ou idée préconçue quant à son identité de genre et ses besoins, en utilisant notamment le prénom et le pronom demandés. L'identité de genre ne doit pas faire l'objet d'une évaluation psychiatrique spécifique. »
Et la HAS d’expliquer : « À l’image de la diversité des situations et besoins, la HAS recommande une prise en charge globale et pluriprofessionnelle, mise en œuvre par une équipe de soins. Les recommandations sont destinées à un large panel de professionnels : médecins généralistes, endocrinologues, psychiatres, psychologues, médecins de la fertilité et de la reproduction, gynécologues-obstétriciens, urologues, chirurgiens plasticiens, médecins du travail, travailleurs sociaux. La HAS préconise que lemédecin généraliste puisse accueillir toute demande de soins et coordonner la prise en charge tout au long du parcours. Il peut assurer le suivi d'une prescription et, s'ilest formé, la primo-prescription des traitements hormonaux d'affirmation de genre. Les recommandations insistent sur l’importance de l’entretien initial avec le médecin généraliste ou un professionnel d'une structure de premier recours. »
Éclairer les demandes de prescription d'hormones et de chirurgie
« La prescription d’hormones aux personnes qui la demandent peut contribuer à améliorer leur qualité de vie. Une évaluation personnalisée des bénéfices et des risques est recommandée, en recherchant notamment des facteurs de risques (vasculaires, oncologiques, cardiologiques…). Concernant la prise en charge chirurgicale, la HAS recommande de répondre aux demandes de chirurgie des personnes trans. Elle souligne la nécessité de délivrer une information préopératoire claire, loyale et adaptée sur les modalités chirurgicales, les risques (à court ou moyen terme) et le caractère irréversible de certains actes pour lesquels un délai de réflexion est prévu, afin de permettre à la personne de donner son consentement éclairé. »
La HAS attire enfin l’attention des pouvoirs publics sur la nécessité de renforcer la formation initiale et continue des professionnels, de structurer l’offre de soins et de mettre en place une organisation territoriale adaptée aux besoins d’accompagnement et de prise en charge médicale et chirurgicale des personnes trans.
Voilà pour les grandes lignes d’un document qui fait une quarantaine de pages et qui comporte de très nombreuses références.
En complément, d'autres infos
sur les personnes trans
Le 17 juin, la Défenseure des droits (DDD) a publié une « nouvelle décision-cadre » relative aux droits des personnes transgenres. En voici les points clefs.
Qu’est-ce qu’une décision-cadre ?
Une décision-cadre est une décision qui lie les parties prenantes quant aux résultats à atteindre. C’est un outil à la fois stratégique et opérationnel, mais qui n’est pas contraignant. Les parties prenantes sont libres de décider de la forme et des moyens mis en œuvre pour atteindre le résultat visé par ladite décision-cadre.
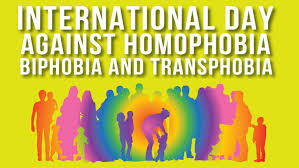
Pourquoi proposer une nouvelle décision-cadre ?
« Depuis 2016, les droits des personnes transgenres en France progressent, avec notamment des démarches facilitées pour le changement d’état civil et l’introduction du critère d’identité de genre à la liste des critères de discriminations » ; avance la Défenseure des droits, qui constate, à travers les saisines qu’elle reçoit et les échanges avec les associations et acteurs-rices de terrain, que de « nombreuses atteintes sont encore régulièrement portées aux droits des personnes transgenres. » Ce constat est également confirmé par les résultats de nombreuses études et enquêtes, comme l’enquête réalisée par l’Agence européenne des droits fondamentaux (FRA) qui montre qu’en 2023, 34 % des personnes LGBTIQ+ déclarent en France s’être senties discriminées dans les douze mois précédant l’enquête, pour une moyenne de 36 % en Europe. Parmi elles, 64 % des personnes transgenres ont déclaré avoir subi une discrimination à raison de leur identité de genre.
En 2020, le Défenseur des droits avait déjà publié une décision-cadre relative au respect de l’identité de genre des personnes transgenres. Dans un contexte de remise en question et de fragilisation des droits des personnes trans et à l’occasion du mois des fiertés, la Défenseure des droits a souhaité publier cette « nouvelle » décision-cadre afin de « réaffirmer l’importance du respect de l’identité de genre, de rappeler le droit applicable, de réitérer ses recommandations et d’en formuler de nouvelles. »
Quel est le périmètre de cette décision-cadre ?
Elle traite des difficultés et des droits des personnes transgenres dans de nombreux domaines : état civil et filiation, santé et protection sociale, droits sexuels et reproductifs, milieux scolaire et périscolaire, enseignement supérieur et formation professionnelle, pratique sportive, emploi, accès aux biens et aux services, déontologie des forces de sécurité et enfin établissements pénitentiaires. Elle attire « l’attention sur les difficultés rencontrées par les personnes étrangères transgenres dans leur accès aux droits ». La DDD y réitère et formule une série de recommandations à destination des pouvoirs publics et de différents-es acteurs-rices.
L’actu vue par Remaides a retenu quelques-uns des items. Sur les autres sujets (non abordés dans cet article), il est recommandé de consulter l’article de présentation de cette décision-cadre sur le site de la DDD.
En matière d’état civil, la Défenseure des droits :
- rappelle que la civilité (« Monsieur », « Madame ») ne constitue pas un élément de l’état civil et recommande donc l’usage de la civilité souhaitée par la personne, ou de supprimer la civilité, dans toute correspondance et échange, même en l’absence de modification de la mention du sexe à l’état civil. Elle encourage les éditeurs-rices de systèmes informatiques à rendre possible techniquement cet usage souhaité de la civilité ;
- réitère auprès du ministre de la Justice sa recommandation de mettre en place des procédures de changement de prénom(s) et de la mention du sexe à l’état civil déclaratoires, accessibles et rapides, par la production auprès des officiers d’état civil d’une attestation sur l’honneur, afin de garantir les droits fondamentaux et la dignité des personnes transgenres ;
- recommande d’ouvrir la possibilité de changer de mention de sexe à l’état civil aux mineurs-es non émancipés-es, dans le cadre d’une procédure judiciaire initiée par les représentants-es légaux-les et au cours de laquelle le consentement de l’enfant devra être recueilli et l’intérêt supérieur de l’enfant apprécié in concreto ;
- réitère sa recommandation d’intégrer dans le CESEDA [code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ndlr] la possibilité de réaliser toute démarche par un canal non dématérialisé, sans condition préalable. Elle recommande également de sensibiliser et former les personnels des préfectures et de l’Ofpra à la transidentité afin de favoriser le respect de l’identité de genre des personnes transgenres ;
- recommande que le marqueur de genre à l’état civil soit respecté pour l’établissement de la filiation et la détermination de la qualité du parent transgenre (père, mère).
En matière de santé et de protection sociale, la Défenseure des droits :
- rappelle l’importance que les futures recommandations sur la prise en charge médicale des personnes transgenres respectent la dépsychiatrisation de la transidentité, l’autodétermination des personnes transgenres et la possibilité de permettre la diversité des parcours de transition médicale ;
- recommande à la Caisse nationale d’assurance maladie de former l’ensemble des personnels des CPAM afin de garantir une prise en charge financière uniforme et non discriminatoire des parcours de transition sur l’ensemble du territoire ;
- recommande d’entamer une réflexion sur une possible prise en charge par l’Assurance maladie des traitements hormonaux prescrits hors autorisation de mise sur le marché (AMM) dans le cadre d’une transition médicale ;
- insiste également sur la nécessaire formation de l’ensemble des professionnels-les de santé à la transidentité ;
- réitère sa recommandation de modifier la règlementation applicable pour garantir à tous-tes les étrangers-ères, quel que soit leur statut administratif, le bénéfice du régime de droit commun de l’Assurance maladie ainsi que le bénéfice d’une prise en charge de leurs frais de santé dès leur arrivée en France ;
- concernant les mineurs-es, appelle à établir un protocole national sur les parcours de transition de genre des mineurs-es dans des délais raisonnables et recommande de développer la recherche sur les mineurs-es transgenres.
Dans le domaine des droits sexuels et reproductifs, la Défenseure des droits :
- recommande de systématiser l’information sur la possibilité d’autoconservation des gamètes avant toute prescription hormonale ;
- de modifier les textes législatifs et réglementaires concernant l’accès aux droits reproductifs afin de permettre l’accès à l’AMP à toute personne quels que soient son identité de genre et son marqueur de genre à l’état civil.
Dans le domaine de l’emploi, la Défenseure des droits recommande aux employeurs privés comme publics :
- de mieux lutter contre les discriminations et le harcèlement discriminatoire fondés sur l’identité de genre ;
- de prendre en considération l’identité de genre de la personne pour l’accès aux vestiaires ou toilettes non mixtes ;
- d’utiliser, lorsque la personne transgenre en exprime le souhait, le prénom choisi et de modifier son titre de civilité sur tous les documents administratifs y compris, les bulletins de salaire, ou supports (messageries électroniques, annuaires internes, intraweb, etc.), que son prénom et sa mention de sexe aient été ou non modifiés à l’état civil.
Dans le domaine de l’accès aux biens et services, la Défenseure des droits rappelle sa recommandation :
-aux établissements privés et aux administrations de respecter l’identité des personnes transgenres en faisant droit à leurs demandes de modification du prénom, du sexe ou du titre de civilité, d’élargir la liste des pièces justificatives d’identité exigées pour la souscription à tout contrat, afin notamment de couvrir les cas des personnes transgenres dont l’apparence physique et les pièces d’identité peuvent être discordantes et de sensibiliser leurs personnels à la transidentité.
Concernant les personnes transgenres détenues, la Défenseure des droits :
- réitère sa recommandation et préconise que les personnes transgenres incarcérées soient affectées dans un établissement ou un quartier correspondant à leur identité de genre dès lors que ces dernières en expriment la volonté, sans attendre que le changement d’état civil soit intervenu ;
- estime que l’identité de genre ne saurait justifier en elle-même une mesure de placement à l’isolement ;
- rappelle que toute personne doit pouvoir cantiner (acheter) les produits d’hygiène et vêtements de son choix, indépendamment de son genre, de son sexe à l’état civil et du quartier dans lequel elle est détenue.

Transitions de genre : la Haute autorité de santé reporte ses recommandations pour les mineurs-es
La Haute autorité de santé (HAS) a annoncé vendredi 18 juillet qu’elle ne se prononcerait finalement pas avant 2026 sur la prise en charge des personnes mineures souhaitant entamer une transition de genre, faisant état d’une « absence de consensus » à ce stade, indique l’AFP. « Nous constatons qu’il y a un consensus sur les majeurs et qu’on ne retrouve pas le même consensus sur les mineurs », a déclaré le président de la HAS, Lionel Collet, lors d’une conférence de presse, précisant que les travaux sur l’élaboration des recommandations pour les personnes mineures débuteraient dès « début 2026 ». L’autorité indépendante a, en revanche, rendu ses recommandations concernant les personnes majeures désireuses de s’engager dans une transition de genre, un avis attendu notamment par les associations de défense des droits LGBT+ qui font régulièrement état d’obstacles rencontrés par les personnes concernées dans leurs parcours de soins. « Concernant la prise en charge chirurgicale, la HAS recommande de répondre aux demandes de chirurgie des personnes trans », indique l’avis.
« La HAS reconnaît à ce titre, dans son avis, que « les conditions d’accès à des soins de qualité restent très hétérogènes sur le territoire », mettant en avant un risque « de renoncement aux soins », « d’automédication » et de troubles mentaux « pouvant aller jusqu’au suicide ». Il convient toutefois, ajoute-t-elle, de « délivrer une information préopératoire claire, loyale et adaptée sur les modalités chirurgicales, les risques (à court ou moyen terme) et le caractère de certains actes pour lesquels un délai de réflexion est prévu, afin de permettre à la personne de donner son consentement éclairé ». « Un avis psychiatrique systématique n’est pas recommandé », mais « un soutien psychologique peut être apporté selon les besoins de la personne », a précisé Claire Compagnon, présidente de la commission des recommandations de la HAS, lors de la même conférence de presse au siège de la HAS à Saint-Denis. Les soins de transition ne sont « pas un confort mais un enjeu vital », a-t-elle ajouté.
Une cycliste belge transgenre privée de compétition fait condamner l’UCI pour discrimination
Reconnaissance. La justice belge a donné raison à une cycliste transgenre qui poursuivait pour discrimination l’Union cycliste internationale (UCI) après un refus de délivrance de licence pour participer à des compétitions féminines, selon une ordonnance de référé communiquée mardi 22 juillet. Le litige, tranché ce mois-ci par le tribunal civil de Bruxelles, remonte à 2023, quand cette cycliste s’était vu signifier le retrait de sa licence et son exclusion des compétitions féminines sur la base d’un nouveau règlement de l’UCI, explique l’AFP. À l’époque, l’organisation internationale s’interrogeait sur le supposé avantage conféré aux femmes transgenres dans les compétitions par le fait « d’avoir franchi le cap de la puberté en tant que garçon ». Elle avait imposé en juillet 2023 aux athlètes transgenres, pour concourir dans la catégorie féminine, de pouvoir prouver avoir « entamé leur transition avant la puberté ou, dans tous les cas, avant l’âge de 12 ans ». Cela en plus de l’obligation déjà en vigueur d’afficher un taux de testostérone très bas. Or la plaignante a effectué sa transition de genre au début de la quarantaine. Elle a estimé que cette mesure conduisant à son exclusion constituait une discrimination. Dans une ordonnance du 10 juillet, le tribunal lui a donné raison en jugeant recevable et fondée son action contre l’UCI. Ce chapitre du règlement médical de l’UCI sur les « règles d’éligibilité pour les athlètes transgenres » instaure « une discrimination interdite » par la législation belge, en vertu d’un décret de décembre 2008 relatif à l’égalité hommes-femmes, a estimé le tribunal, cité par l’AFP. Par conséquent, ces règles sont déclarées « nulles », et l’UCI n’a plus aucune justification pour refuser à la plaignante sa participation à une compétition féminine de cyclisme, est-il souligné, selon une copie de l’ordonnance communiquée à la presse. L’ordonnance est « directement exécutoire » et fait jurisprudence en Belgique, s’est félicité l’Institut pour l’égalité des femmes et des hommes, qui était partie civile dans le dossier. Sollicitée par l’AFP, la Fédération belge de cyclisme a indiqué avoir entamé une concertation avec l’UCI « concernant l’application future des règlements ». La fédération, Belgian Cycling, était également citée dans la plainte pour refus de renouvellement de licence. Elle n’a pas été condamnée car le tribunal a estimé qu’elle n’avait fait qu’appliquer les règles de l’UCI.
Jeux olympiques. Le comité américain exclut les femmes transgenres des épreuves féminines
Recul. Les femmes transgenres américaines ne pourront plus participer aux épreuves féminines des Jeux olympiques et paralympiques, le Comité olympique et paralympique des États-Unis vient de changer sa politique pour se conformer au décret de Donald Trump. Cette « mise à jour » de la politique du comité olympique américain (USOPC) est entrée en vigueur le 21 juillet pour faire suite au décret présidentiel signé en février par Donald Trump et intitulé, de façon transphobe : « Keeping Men Out of Women’s Sports » (« Tenir les hommes à l’écart du sport féminin »). Elle a été ajoutée à la politique de sécurité des athlètes de l’USOPC sur son site internet, dans une nouvelle sous-section intitulée « Exigences supplémentaires ». Dans une note adressée à l’équipe américaine (Team USA), obtenue par ABC News et ESPN, la directrice générale de l’USOPC, Sarah Hirshland, et le président Gene Sykes font référence au décret présidentiel de février, déclarant : « En tant qu’organisation à charte fédérale, nous avons l’obligation de nous conformer aux attentes fédérales. » Le décret de Trump menace de priver de fonds fédéraux toute école ou institution permettant aux femmes transgenres de jouer dans des équipes féminines, estimant que cela violerait le Titre IX, qui garantit l’égalité d’accès des femmes au sport. « Notre politique révisée met l’accent sur l’importance d’assurer un environnement de compétition équitable et sécurisé pour les femmes », affirme l’USOPC dans une lettre adressée aux instances sportives. « Toutes les fédérations sportives nationales doivent mettre à jour leurs politiques en conséquence ». Cette décision intervient alors que Los Angeles se prépare à accueillir les Jeux olympiques d’été de 2028.
Hong Kong : une personne transgenre fait changer la législation sur les toilettes publiques
Une législation hongkongaise qui criminalisait les personnes se rendant dans des toilettes publiques réservées au sexe opposé a été modifiée mercredi 23 juillet par un tribunal de Hong Kong. Cette décision a été saluée comme « un pas en avant » pour le droit des personnes transgenres. L’affaire a été portée devant la justice en 2019 par un homme transgenre qui avait été encouragé par ses médecins à utiliser les toilettes publiques pour hommes dans le cadre de sa prise en charge. Sa carte d’identité de Hong Kong l’identifiait alors toujours comme une femme, ce qui pouvait l’exposer à une amende allant jusqu’à 2 000 dollars de Hong Kong (217 euros) en vertu des règles en vigueur. Le plaignant a estimé qu’une telle sanction violait ses droits à l’égalité, à la vie privée et à l’absence de discriminations. Le juge Russell Coleman, de la Haute Cour, lui a donné raison, assurant que ces lois « constituent une atteinte disproportionnée et inutile à la vie privée et au droit à l’égalité ». « De nombreuses personnes transgenres choisissent de ne pas utiliser les toilettes publiques, par peur, en raison d’une menace de harcèlement et pour éviter que leur identité de genre ne soit contestée », a commenté le juge Coleman. Il a donné un an au gouvernement hongkongais pour « considérer la manière dont il veut mettre en place des moyens pour traiter cette infraction ». L’exécutif a déclaré qu’il étudierait cette décision et qu’il allait envisager des mesures de suivi.
Transphobie : les époux Macron poursuivent en diffamation une influenceuse américaine
Le président français Emmanuel Macron et son épouse Brigitte poursuivent en diffamation l’influenceuse américaine Candace Owens aux États-Unis pour avoir relayé et exploité l’infox selon laquelle Brigitte Macron serait une femme transgenre. Les poursuites en diffamation ont été engagées le 23 juillet dernier. Cette infox resurgissant régulièrement en France sur les réseaux sociaux, notamment des sphères complotistes d’extrême droite, depuis la première élection d’Emmanuel Macron en 2017 a prospéré à l’étranger. En particulier aux États-Unis après que la blogueuse d’extrême droite Candace Owens s’en est emparée en mars 2024, lui donnant un écho mondial depuis janvier 2025 par une série de vidéos intitulée « Becoming Brigitte » (« Devenir Brigitte »). Dans leur plainte de 218 pages, le couple Macron accuse la figure de l'extrême droite américaine d’avoir diffusé des « récits extravagants, diffamatoires et invraisemblables ». « Le principe ici, c’est la vérité », a déclaré Thomas Clare, l'avocat d'Emmanuel et Brigitte Macron. « Ils estiment qu’il est important de se défendre… Owens a eu plusieurs occasions de faire ce qu’il fallait, et elle n’a fait que se moquer d’eux en retour », a-t-il ajouté. À noter que le président de la République et la première dame se sont dit prêts à se rendre aux États-Unis pour comparaître en personne lors du procès, indique l’AFP.
