L'Actu vue par Remaides :LAMIS 2025 : une enquête en ligne pour comprendre la santé des hommes gays et bisexuels en Amérique latine et dans les Caraïbes
- Actualité
- 08.10.2025
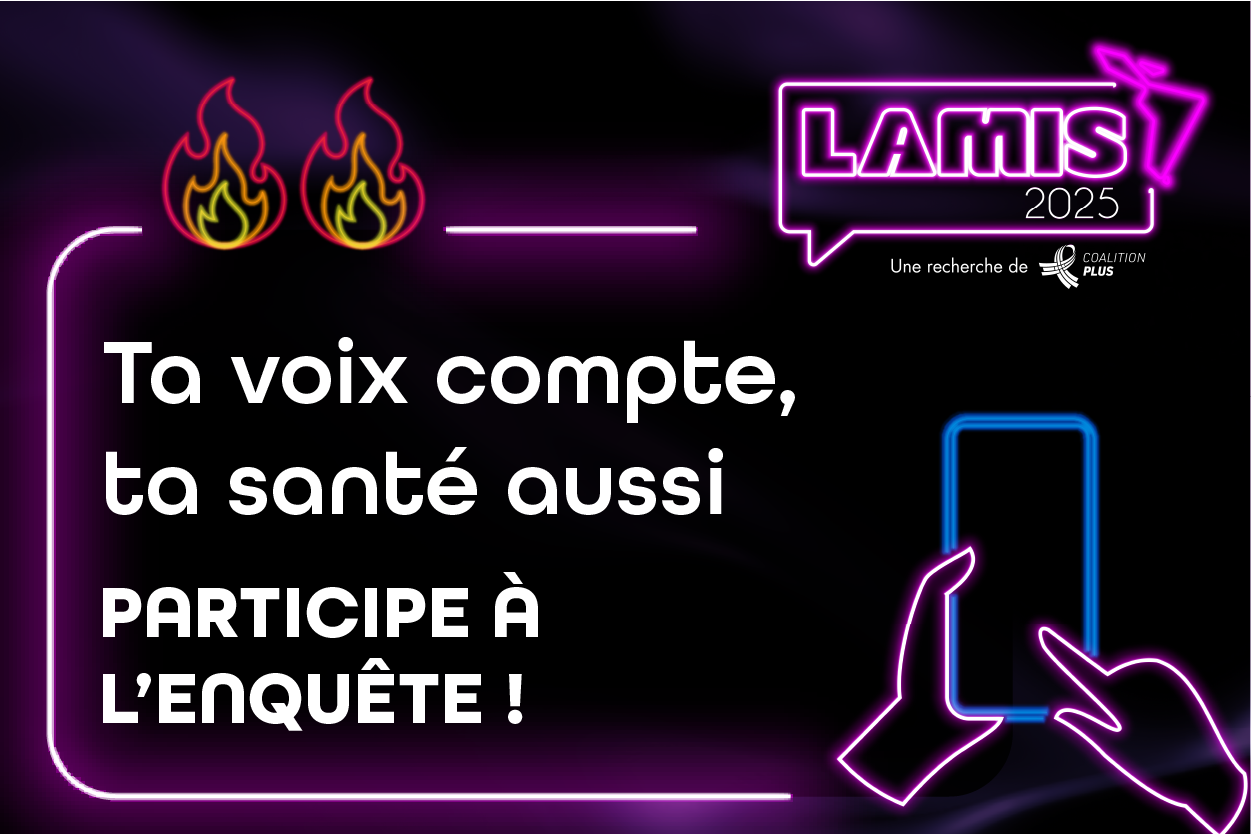
Photo : Coalition PLUS
Propos recueillis par Fred Lebreton
LAMIS 2025 : une enquête en ligne pour comprendre la santé des hommes gays et bisexuels en Amérique latine et dans les Caraibes
Sept ans après sa première édition, l’étude LAMIS revient avec une ambition élargie : explorer 24 pays et territoires d’Amérique latine et des Caraïbes pour mieux comprendre les réalités de santé sexuelle, mentale et sociale des hommes gays, bisexuels et autres hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes (HSH). Menée par Coalition PLUS et le réseau Right PLUS, cette enquête en ligne s’appuie sur un fort ancrage communautaire. Entretien avec Nicolas Lorente, responsable de la recherche communautaire à Coalition PLUS et co-investigateur de l’étude LAMIS 2025.
Remaides : Pouvez-vous dire quelques mots sur la première édition de LAMIS en 2018 ?
Nicolas Lorente : LAMIS, qui signifie Latin American MSM Internet Survey [Enquête en ligne auprès des HSH en Amérique latine, ndlr], a constitué en 2018 la première étude régionale couvrant l’ensemble de l’Amérique latine. Elle a été réalisée dans 18 pays, en s’inspirant du modèle de l’étude EMIS [European MSM Internet Survey, ndlr]. Ce projet a vu le jour grâce à la collaboration de partenaires académiques de la péninsule ibérique ainsi que du Chili, du Brésil et du Pérou. À l’issue de ce travail, ces partenaires ont constitué un réseau baptisé Right PLUS, le Réseau ibéro-américain de recherche sur le VIH chez les hommes gays, bis et HSH et les personnes trans. Ce réseau a ensuite intégré Coalition PLUS et a accueilli les organisations communautaires membres de Coalition PLUS présentes dans la région ibéro-américaine. Cela a permis d’élargir son champ d’action, qui n’est plus limité, aujourd’hui, aux HSH et aux personnes trans. Voilà, sept ans ont passé depuis cette première édition.
Remaides : Quels constats ou évolutions depuis la dernière édition de LAMIS rendent cette nouvelle étude nécessaire aujourd’hui en Amérique latine et dans les Caraïbes ?
Depuis LAMIS 2018, beaucoup de changements ont eu lieu en Amérique latine et dans les Caraïbes. D’ailleurs, une nouveauté importante de cette édition est justement l’inclusion des Caraïbes dans LAMIS 2025. Parmi les évolutions notables, on peut citer la démocratisation de la Prep, même si elle reste limitée à certains pays. De nouvelles stratégies de prévention ont aussi émergé, comme le Doxypep [méthode de prévention qui consiste à prendre un antibiotique (la doxycycline) après un rapport sexuel non protégé par un préservatif (entre 24 heures et 72 heures au maximum après le rapport), ndlr], encore très peu disponible, mais déjà présent dans quelques contextes spécifiques. Entre-temps, nous avons également traversé de nouvelles crises sanitaires, avec l’épidémie de Covid-19, puis celle du Mpox. Il faut aussi rappeler que l’Amérique latine et les Caraïbes sont marquées par des contextes sociopolitiques particulièrement instables : hyperinflation dans plusieurs pays, conflits récurrents, montée de l’extrême droite… Dans ce cadre, il devenait essentiel de savoir où en est aujourd’hui la population des hommes gays, bisexuels et, plus largement, des autres hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes. L’objectif est d’évaluer leur situation en matière de santé sexuelle, de voir ce qui a changé, ce qui s’est amélioré ou, au contraire, aggravé, et de pouvoir ainsi informer les décideurs politiques. Enfin, il faut mentionner que LAMIS 2025 a pu voir le jour grâce au soutien financier de l’AFD [Agence française de développement, ndlr].
Remaides : Quels sont les profils ciblés et comment faites-vous pour toucher un public aussi large, dans 24 pays et de surcroît en plusieurs langues ?
L’étude s’adresse à l’ensemble des hommes gays, bisexuels et autres hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes [GBHSH, ce qu’on appelait auparavant simplement HSH, ndlr]. Elle concerne les 24 pays inclus dans le périmètre de l’étude, parmi lesquels certains territoires et îles des Caraïbes, comme la Guyane française et les Antilles. L’enquête est disponible en quatre langues : espagnol, portugais, français et néerlandais, pour le Suriname, pays qui était déjà partenaire en 2018. Les profils concernés recouvrent des réalités extrêmement diverses. Tout dépend, par exemple, du lieu de résidence : vivre en milieu urbain ou en milieu rural ne s’accompagne pas des mêmes expériences, notamment en matière de visibilité, de risque d’exposition aux violences ou à la stigmatisation. L’un des enjeux majeurs de LAMIS est donc de refléter toute cette diversité, et pas uniquement les profils de gays urbains, « out » [ouvertement gay, ndlr], socialement intégrés et relativement épargnés par les discriminations. Pour cela, nous diversifions au maximum les canaux de recrutement. Un kit de communication a été élaboré dans les quatre langues pour l’ensemble des pays, avec la possibilité de l’adapter localement. La promotion passe beaucoup par Internet, à travers les réseaux sociaux et les applications de rencontres. Mais les organisations communautaires, partenaires de l’enquête LAMIS depuis ses débuts, jouent un rôle crucial. Elles sont très actives, que ce soit via leurs propres réseaux sociaux, leurs groupes WhatsApp, leurs activités de terrain ou dans leurs locaux, avec des affiches et flyers. Certaines vont jusqu’à créer des formats originaux, comme des vidéos adaptées à leurs contextes nationaux, reprenant, par exemple, les couleurs ou symboles des pays ou zones concernés.
Remaides : Au-delà de la santé sexuelle, on comprend que LAMIS explore aussi la santé mentale, l’usage de substances ou l’impact des violences : pourquoi cette approche multidimensionnelle ?
Tout simplement parce qu’on sait depuis longtemps que la santé mentale, l’usage de substances et les expériences de violences subies exercent une influence directe sur les comportements sexuels. Ces facteurs sont donc forcément associés à une meilleure ou moins bonne santé sexuelle, en général. On sait, par exemple, que les populations clés, c’est-à-dire celles qui sont les plus exposées au VIH, subissent davantage de discriminations et de violences. Les hommes gays et HSH, en particulier, sont plus souvent confrontés à ces situations. De fait, leur santé mentale est souvent plus dégradée que celle de la population générale. Concernant l’usage de substances psychoactives, ce que l’on observe aujourd’hui en Amérique latine et dans les Caraïbes, c’est que, même si les produits et les termes varient, le phénomène est bien présent. On ne parle pas forcément de « chemsex » dans cette région, mais les organisations communautaires rapportent de plus en plus l’usage de drogues ou de substances en contexte sexuel. Ce n’est pas nouveau en soi, mais les pratiques proches du chemsex tel qu’on l’entend en Europe (par exemple des sessions pouvant durer plusieurs jours), sont désormais décrites plus fréquemment par les acteurs de terrain. Or, on sait que ce type de consommation est associé à un risque accru d’infections, d’autant plus dans des contextes où la Prep n’est ni disponible, ni accessible partout. C’est pourquoi cette approche multidimensionnelle nous semble essentielle : elle permet de mieux comprendre l’ensemble des besoins et des problématiques des différents profils d’hommes gays, bisexuels et HSH. Elle aide aussi à expliciter les liens entre ces différents facteurs, afin d’ajuster et d’informer plus efficacement les politiques de santé publique.

Crédit image : Diago Astarita (instagram: @astadiego)
Remaides : Comment garantir la fiabilité des résultats dans une enquête en ligne ouverte à tous ?
Je vais peut-être commencer par une mauvaise nouvelle : on ne peut jamais garantir à 100 % la fiabilité de données dites « déclaratives ». Autrement dit, lorsqu’on interroge des personnes sur leurs comportements, leurs opinions ou leurs pratiques, que ce soit en ligne, en face à face, en questionnaire auto-administré ou administré, il existe toujours une limite inhérente à ce type de données. Cela dit, d’un point de vue scientifique et statistique, nous disposons d’un certain nombre d’outils qui permettent de minimiser ce risque, dès la préparation et la structuration des questionnaires. Par exemple, le fait de travailler avec des échantillons suffisamment grands permet de limiter l’impact des réponses non fiables, qui, sinon, risqueraient de brouiller les résultats. Nous utilisons aussi des critères de sélection dès le début du questionnaire, afin de nous assurer que seules les personnes réellement ciblées puissent répondre. Dans notre cas, il s’agit des « hommes attirés par d’autres hommes », avec des critères supplémentaires comme l’âge ou le pays. À l’intérieur même des questionnaires, nous intégrons également des filtres. Ainsi, si une personne déclare ne pas avoir consommé de substances psychoactives au cours des douze derniers mois, elle ne sera pas confrontée aux questions qui y sont liées. Cela évite l’effet de lassitude, le fameux enchaînement de réponses « non, non, non », et permet de maintenir l’engagement jusqu’à la fin. Enfin, nous utilisons des échelles [d’évaluation, ndlr] validées, notamment en santé mentale, qui reposent sur des protocoles stricts. On sait, dans ce cas, que les réponses obtenues sont fiables.
Remaides : Quels rôles jouent les organisations communautaires dans ce processus ?
Dans la conception de la recherche communautaire à Coalition PLUS, nous insistons fortement pour que les organisations communautaires soient impliquées dès le début, lors des premières réflexions et réunions de travail. Cela a été le cas dans LAMIS 2025, où nous avions même plus de partenaires communautaires que de partenaires académiques dans le consortium. Leur participation contribue à renforcer la fiabilité des résultats, car elles vérifient que les questions soient bien formulées, adaptées aux réalités des personnes concernées et en phase avec leurs préoccupations. Cette implication suscite un meilleur intérêt et davantage d’envie de répondre sérieusement au questionnaire. Leur rôle est également essentiel dans la promotion et le ciblage : elles vont directement vers les populations concernées, ce qui accroît la pertinence de l’enquête. J’insisterais aussi sur la dimension pédagogique : malgré leurs contraintes de temps et de moyens, les organisations communautaires prennent le temps de produire des vidéos, des témoignages, d’animer des groupes de discussion, et de rappeler en quoi il est important de répondre à l’étude. Ce travail de sensibilisation est précieux. D’ailleurs, le slogan choisi par la majorité des partenaires résume parfaitement cette démarche et l’enjeu : « Ta voix compte, ta santé aussi ».
Remaides : À qui s’adressent les résultats, et comment espérez-vous qu’ils influencent concrètement les politiques de santé ou les pratiques de terrain ?
Les résultats s’adressent à l’ensemble des acteurs et actrices de la lutte contre le VIH : les organisations communautaires, les décideurs politiques, les scientifiques, mais aussi certains organismes internationaux, comme l’Onusida [le programme des Nations Unies de lutte contre le VIH, ndlr]. Cet organisme avait déjà publié en 2018 des indicateurs issus de LAMIS et nous travaillons à nouveau avec lui pour intégrer certaines de nos données dans son rapport épidémiologique annuel, ainsi que dans l’« Atlas des populations clés » [une carte mondiale présentant différents indicateurs selon les pays et les populations, ndlr]. De notre côté, la priorité sera de publier un rapport global. Nous ne pourrons pas être exhaustifs, mais nous mettrons en avant les informations les plus importantes à l’échelle régionale, en regroupant également les pays en sous-régions afin de dégager des tendances majeures sur le continent. Certaines organisations disposent déjà de capacités d’analyse, d’autres moins : nous tenterons donc d’accompagner, dans la mesure du possible, celles qui en ont le plus besoin, via le réseau Right PLUS, mais aussi à travers des partenariats nationaux avec des universités ou des centres de recherche. L’objectif est que les organisations communautaires puissent accéder directement à leurs propres données, sélectionner celles qui leur sont utiles et s’en servir pour renforcer leur plaidoyer national et améliorer l’accès aux services de santé. Nous souhaitons également organiser des restitutions communautaires, sous forme d’infographies simples ou d’ateliers. Ces ateliers réuniront des personnes issues des communautés enquêtées, des membres d’organisations locales et des représentants des politiques publiques ou des agences de santé. L’idée est de présenter les résultats, susciter des réactions, obtenir des retours et parfois éclairer certains éléments statistiques que nous ne parvenons pas à interpréter seuls. Enfin, les résultats feront l’objet de présentations scientifiques lors de conférences et de publications dans des revues scientifiques. C’est une étape importante pour le plaidoyer : disposer de données validées scientifiquement leur donne un poids supplémentaire. La base de données sera par ailleurs disponible sur demande via un formulaire en ligne sur le site de Coalition PLUS. Elle pourra être consultée à différents niveaux – régional, national ou plurinational – afin de permettre à d’autres acteurs de mener leurs propres analyses et de prolonger le travail au-delà du consortium ou du réseau Right PLUS.
Remaides : Où en êtes-vous dans le recrutement et quand peut-on espérer voir les premiers résultats ?
Aujourd’hui [10 septembre 2025, date de l’entretien, ndlr], nous sommes à peu près à la moitié de la période de recrutement, initialement prévue sur quatre mois mais qui sera probablement prolongée jusqu’au début décembre 2025. Dans certains pays, nous avons déjà presque atteint les effectifs de 2018, alors même que nous n’avons pas encore lancé les grandes campagnes promotionnelles via Grindr, Scruff ou Tinder. Pour mémoire, en 2018, Grindr représentait à lui seul entre 60 à 70 % des participants recrutés. Notre objectif est ambitieux : atteindre au moins 65 000 participants, comme lors de la première édition. Mais le contexte a changé : à l’époque, il y avait l’effet de nouveauté : c’était la première grande enquête de ce type, et beaucoup voulaient « faire entendre leur voix ».
Depuis, plusieurs épidémies et d’autres études sont passées par là, et l’on constate une certaine fatigue à répondre aux enquêtes, comme on l’observe déjà en Europe. D’où l’importance d’une mobilisation communautaire forte, active et créative, pour maintenir la dynamique et viser le plus grand échantillon possible. Nous espérons pouvoir présenter les premiers résultats préliminaires courant 2026, peut être lors de la conférence de l’IAS [la conférence mondiale sur le sida, ndlr] qui se tiendra au Brésil en juillet 2026.
